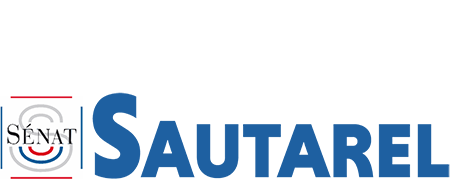La principale spécificité du FPIC, qui suscite encore de vives controverses, est l’échelle à laquelle s’opère la redistribution horizontale des ressources. En effet, dans le cadre du FPIC, celle-ci n’est pas opérée entre les communes mais entre les territoires. En pratique, cette notion de « territoire » est matérialisée par la création d’une catégorie nouvelle, l’ensemble intercommunal (EI), qui regroupe l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres.
Ce dossier sera un des principaux à activer dès 2022 pour assurer un nouvel équilibre du territoire par une juste répartition des richesses et une réelle prise en compte de la réalité des charges.