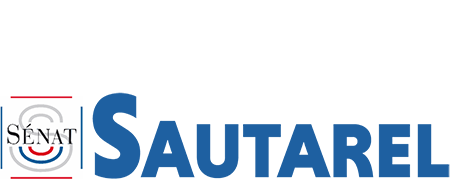Les Mapuches (littéralement « Peuple de la terre » en mapudungun) sont un groupe ethnique et peuple autochtone du Chili et d’Argentine formant plusieurs communautés, connues également sous le nom d’Araucans. Au sens strict, le terme Mapuches désigne les Amérindiens habitant l’Araucanie ou Arauco, coïncidant grosso modo à l’actuelle région administrative chilienne d’Araucanie.
Les Mapuches eurent à faire face d’abord aux visées expansionnistes des Incas auxquels ils résistèrent ; puis, au xvie siècle, aux tentatives de conquête des conquistadors espagnols, qui venaient de renverser l’Empire inca et trouvèrent face à eux les autres Mapuches établis entre la vallée de l’Aconcagua et le centre de l’île de Chiloé. La résistance du chef mapuche Lautaro, qui avait appris la tactique et la stratégie militaires lorsqu’il était prisonnier des Espagnols, et dont les troupes possédaient une grande maîtrise du cheval, et plus tard la rébellion de Pelantaro en 1602, aboutirent à fixer la frontière militaire entre Espagnols et Mapuches au niveau de la rivière Biobío (à 470 km environ au sud de Santiago) ; depuis lors, les Espagnols hésitaient à se risquer en territoire mapuche.
Entre 1860 et 1880, les deux États de la région issus de la décolonisation, le Chili et l’Argentine, entreprirent à leur tour des guerres de conquête contre les Amérindiens (Mapuches et Patagons) qui vivaient au sud du continent dans des régions restées hors de leur contrôle et difficilement pénétrables, et viendront finalement à bout de la résistance mapuche.
Aux xxe et xxie siècles, les Mapuches subiront un processus d’acculturation et d’assimilation aux sociétés des deux États (argentin et chilien), mais au rebours duquel se feront jour des manifestations de résistance culturelle et éclateront çà et là des conflits parfois violents (avec mort d’homme) centrés autour de la propriété des terres, de la reconnaissance de leurs organisations et de la pratique de leur culture.
Le système économique traditionnel, basé sur la chasse et l’horticulture, a cédé le pas, aux xviiie et xixe siècles, à une économie agricole et d’élevage, les Amérindiens se convertissant dès lors, après l’implantation forcée sur des terrains à eux assignés par le Chili et l’Argentine, en un peuple de paysans voué à l’heure actuelle (2018) à une grande fragmentation culturelle, à un morcellement de la propriété, et à une migration vers les grandes villes par les générations plus jeunes, qui a eu pour effet de faire des Mapuches une population aujourd’hui majoritairement urbaine, établie principalement à Santiago du Chili et à Temuco, quoique préservant des liens plus ou moins serrés avec ses communautés d’origine.
Ils sont environ 2 millions et sont aujourd’hui victime d’une forestation qui met en péril leur accès à l’eau. Leur territoire est placé sous un couvre feu sévère malgré le régime démocratique en place au Chili.
Avec près de 242 millions d’habitants en 2023, le Pakistan est le cinquième pays le plus peuplé du monde, avec la deuxième plus nombreuse population musulmane après l’Indonésie. C’est une république fédérale dont les provinces disposent d’une certaine autonomie. Les frontières des quatre provinces correspondent approximativement aux principales ethnies. L’ourdou est la langue officielle du pays mais la majorité de la population parle l’une des langues en usage dans les principales ethnies du pays, à savoir le pendjabi, le pachto, le sindhi et le baloutchi.
L’Inde a décidé de « suspendre » sa participation au traité sur les eaux de l’Indus après l’attentat au Cachemire de mardi dernier, qui a fait 26 victimes civiles. Cette annonce a entraîné une très vive réaction d’Islamabad, qui évoque un potentiel « acte de guerre ». Comment un traité autour d’un fleuve peut-il rendre si explosives les relations entre les deux voisins ?
Cette interruption de l’accord fait partie des mesures de rétorsion décidées par les autorités indiennes, qui ont accusé Islamabad d’être en partie responsable de la fusillade ayant fait 26 victimes civiles au Cachemire, soit l’attaque la plus meurtrière pour des non-combattants depuis depuis le début du siècle dans cette région.
Islamabad, qui a nié être impliqué dans cet attentat, a vivement réagi aux sanctions indiennes, parmi lesquelles la fermeture du poste-frontière indien dans le Cachemire et l’annulation des visas. Le Pakistan a répliqué en fermant son espace aérien aux compagnies indiennes et en annulant tout commerce bilatéral.
Mais la suspension unilatérale du traité des eaux de l’Indus menace d’être la goutte qui fait déborder le vase. Le ministre indien de la Gestion de l’eau a même affirmé que les autorités travaillent à des mesures pour s’assurer qu’aucune goutte d’eau n’arrive au Pakistan. Islamabad a prévenu qu’il assimilerait à un « acte de guerre » toute initiative indienne pour réduire le volume d’eau se déversant dans l’Indus depuis ses affluents contrôlés par l’Inde.
L’attaque terroriste dans le Cachemire risque donc de dégénérer en guerre de l’eau entre deux puissances régionales dotées de l’arme nucléaire. Pas étonnant lorsqu’on connaît l’importance de l’Indus pour la région et surtout pour la population pakistanaise.
Ce fleuve, qui traverse trois pays (Inde, Pakistan, Chine), est une source d’eau cruciale pour quelques 268 millions de personnes. Près de 80 % de l’agriculture pakistanaise dépend de l’eau de l’Indus, et on estime que 25 % du PIB pakistanais provient d’activités liées à ce fleuve.
Le traité des eaux de l’Indus, signé en 1960 entre l’Inde et le Pakistan sous l’égide de la Banque mondiale, doit garantir un accès équitable au fleuve pour tous. Il confère à l’Inde le contrôle de trois affluents à l’Est – la Ravi, la Sutlej et la Beas – tandis que le Pakistan supervise les affluents plus à l’Ouest – la Chenab et la Jhelum –, ainsi que le fleuve Indus lui-même.
Ce traité est considéré comme l’un des plus grands succès en matière de partage international des eaux. L’accord n’a, en effet, jamais été remis en cause malgré les nombreux conflits entre ces deux pays voisins et des décennies de tensions autour du statut du Cachemire.
Le gouvernement indien a fait monter la pression sur le Pakistan en franchissant une étape… qui n’existe pas. Le traité des eaux de l’Indus ne comporte pas de clause de suspension.
Si les autorités de New Delhi décidaient d’abandonner le traité, les conséquences pourraient être catastrophiques pour le Pakistan.
Mais tout ça ne se fera de toute façon pas dans l’immédiat. L’Inde ne peut tout simplement couper le robinet à eau dans l’Indus.
Le retrait du traité introduit cependant une grande incertitude, ce qui peut être très dommageable pour le Pakistan. En effet, les autorités indiennes n’auraient plus à respecter les clauses du traité, ce qui leur permettrait de construire les barrages qu’elles veulent sans même avoir à en informer Islamabad. Il y aurait donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête des agriculteurs pakistanais.
Les Indiens ne seraient plus non plus tenus de partager les informations sur le niveau de l’eau dans les affluents qu’ils contrôlent. Toute cette imprévisibilité peut avoir un coût économique important : les investisseurs seront d’autant moins prêts à miser sur l’agriculture pakistanaise s’ils ne savent pas de quoi l’avenir sera fait. Surtout que le réchauffement climatique entraîne déjà une certaine incertitude.
Le chantage au traité des eaux de l’Indus représente un grand atout pour l’Inde, qui « peut rapidement dégénérer en situation incontrôlable », puisque le Pakistan peut difficilement se permettre de laisser l’Inde brandir cette menace sans réagir.
C’est donc un pari très risqué pour l’Inde aussi. Pourquoi avoir choisi cette attaque au Cachemire pour faire monter ainsi la pression ? D’abord, « parce que le gouvernement indien exige depuis des années que le Pakistan prenne des mesures fortes contre le terrorisme qui, aux yeux de New Delhi, ne viennent pas. C’est donc une sorte de dernier recours avant un conflit ouvert dont personne ne veut ».
Il faut aussi prendre en compte le moment de l’attaque. Celle-ci est intervenue alors que le vice-président américain J.D. Vance était en visite officielle dans le pays. Blessée dans son orgueil de superpuissance régionale en devenir devant son puissant allié américain, l’Inde se devait de réagir fortement à cette attaque. « C’est probablement le signe que l’Inde de Narendra Modi, qui estime être plus puissante sur la scène internationale qu’en 2016, voulait montrer très clairement que, cette fois-ci, les autorités sont prêtes à aller très loin pour forcer les Pakistanais à prendre des mesures contre le terrorisme. C’est aussi en ligne avec le discours plus agressif et nationaliste de Narendra Modi ».
Le risque est que le Pakistan refuse de se laisser faire. « Il ne faut pas oublier que les deux pays ont des ‘grands frères’ très puissants qu’ils peuvent appeler à la rescousse », note Amalendu Misra. Le gouvernement pakistanais pourrait ainsi demander à la Chine d’intervenir, tandis que l’Inde espère pouvoir compter sur l’appui des États-Unis.
La grande question est de savoir comment ces deux superpuissances réagiront si elles sont sollicitées. Le scénario du pire serait que Washington et Pékin, déjà en froid en raison de la guerre commerciale en cours, se laissent entraîner dans ce conflit régional. Les « grands frères » pourraient pousser à l’apaisement pour éviter d’ajouter un conflit entre pays dotés de l’arme atomique à une situation internationale déjà suffisamment dangereuse comme ça.
On le voit les tensions internationales ne manquent pas.