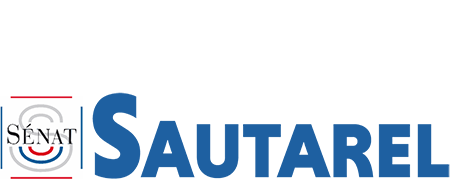En marge de deux réunions sur la biodiversité et nos écosystèmes au titre de la gestion de zone Natura 2000 dont la Région
#auvergnerhonealpes a la responsabilité, et d’une réunion de l’Agence de l’eau Adour Garonne qui a finalement été annulée (peut être à cause de la canicule bordelaise !), je voulais m’arrêter un moment sur ce qui ne peut plus être ignoré, ce face à quoi on peut se sentir impuissant, et pourtant qui exige des modifications radicales de comportements et de pratiques : l’urgence climatique.

Il y a un demi-siècle, René Dumont, premier candidat écologiste à l’élection présidentielle, buvait face caméra « un verre d’eau précieuse », en redoutant qu’elle vienne bientôt à manquer si la société humaine ne prenait pas mieux soin de son environnement. Nous y sommes. Chaque jour ou presque, on découvre de nouveaux éléments sur la contamination des nappes phréatiques les plus profondes par les métabolites de pesticide, les microplastiques et les polluants éternels. Le scandale des minéraliers, qui auraient eu recours à des traitements interdits, n’est que la partie émergée d’une vérité vertigineuse : il n’y a plus d’eau pure. Pas seulement en France, mais partout sur la planète (une étude de l’université de Stockholm a montré il y a quelques années que même l’eau de pluie tombant sur le plateau tibétain recelait des produits de synthèse toxiques…).

A cette dégradation qualitative hélas prévisible, qui implique des traitements de plus en plus complexes et onéreux, s’ajoute un nouveau motif d’inquiétude, moins évident dans un pays historiquement habitué au confort d’un climat tempéré : la raréfaction quantitative de la ressource. Le récent rapport du Haut Commissariat au plan sur « l’eau en 2050 » dresse un état des lieux assez dramatique : « Sans inflexion des tendances actuelles, 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère en été en matière de prélèvements. » Même en cas de printemps-été humide, près de la moitié des bassins-versants français connaîtraient une situation de déficience, multipliant les conflits d’usage. Dans les pires des cas, des exodes de population vont s’organiser à l’échelle planétaire comme à l’échelle européenne. Toutes les technologies du monde ne peuvent s’affranchir en effet d’une réalité physique, à savoir que l’eau est une ressource locale.

Comme le rappelle un important rapport parlementaire coredigé par mon collègue député du Cantal
Vincent Descoeur, le cycle de l’eau est de plus en plus affecté par le changement climatique. La fragilité de la ressource a été mise en évidence par la sécheresse exceptionnelle de l’été 2022 qu’on risque de connaître de nouveau cette année. Les années 2022 puis 2023 ont été marquées par de funestes records : déficits de précipitations, nappes phréatiques à un niveau historiquement bas, ruptures d’eau potable sur tout ou partie du territoire de plusieurs centaines de communes, plusieurs dizaines de départements contraints d’adopter des mesures de restriction d’eau. Pendant l’été 2022, 43 % des cours d’eau ont connu des assecs et on a pu constater des déficits de précipitations entre 10 à 50 % sur la totalité du territoire. La sécheresse peut également être hivernale : entre le 21 janvier et le 21 février 2023, on a constaté 32 jours sans aucune précipitation sur l’ensemble du territoire. Depuis plusieurs années, les glaciers perdent leur capacité à stocker de l’eau douce, conformément aux prévisions les plus pessimistes. Les faibles débits mais également l’augmentation de la température de l’eau ont des conséquences sur la vie aquatique, la biodiversité et les activités humaines, dont plusieurs ont été impactées voire interrompues. La situation dans certains territoires d’outre-mer, notamment à Mayotte, déjà confrontée à des difficultés d’approvisionnement en eau, est aggravée par le changement climatique. À l’inverse, depuis la mi‑octobre 2023, les fortes inondations qui ont touché le Nord-Pas-de-Calais, la région Poitou-Charentes, le Jura, les Hautes-Alpes puis la Haute‑Savoie donnent une illustration de ce type d’évènements extrêmes dont la fréquence pourrait fortement augmenter dans les années à venir. Partout, le changement climatique, en provoquant une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des précipitations extrêmes, met à nu une dégradation réelle des écosystèmes régulateurs du cycle de l’eau. Le constat est unanime sur le risque de répétition de ces évènements dans le temps.

Dans ce contexte, les conflits d’usage et les tensions autour de l’eau sont amenés à prendre de l’ampleur. Pour améliorer la résilience de nos territoires face aux risques qui pèsent sur la disponibilité actuelle et future de la ressource en eau, nous devons nous adapter structurellement et dans la durée à une nouvelle donne climatique qui nous impose de réduire notre consommation en eau. Ainsi, l’ensemble des politiques de l’eau doivent, dans un contexte de changement climatique, s’articuler autour d’exigences visant à restaurer le cycle de l’eau et à préserver sa quantité autant que sa qualité. Il s’agit de faire en sorte d’éviter une « guerre de l’eau » en donnant conscience à l’ensemble de la population de la fragilité de la ressource en eau et de sa valeur.

Ces projections sont conformes aux prévisions des climatologues. Le dérèglement climatique n’entraînera pas nécessairement une baisse globale des précipitations, mais renforcera leur saisonnalité, avec davantage d’inondations l’hiver et de sécheresses l’été – comme l’année en cours l’illustre parfaitement. Une telle perturbation du cycle de l’eau suffira à créer des pénuries. La conclusion est sans appel : avoir de l’eau au robinet, qui plus est de l’eau potable, ne coule plus de source. Si l’Etat s’en inquiète aujourd’hui, c’est que la distribution d’eau constitue, depuis la Révolution française au moins, le coeur du coeur des missions régaliennes. Et là comme ailleurs c’est bien au plus près du terrain que l’on peut et doit agir. Le maillage communal de la France est une réelle chance à cet égard.

Les travaux de la mission d’information montrent qu’il n’existe pas de solution unique dans ce domaine, mais qu’il faut agir simultanément sur différents fronts. Dans ce « bouquet de solutions », on peut identifier plusieurs leviers d’amélioration qui s’articulent autour des exigences suivantes :
– Mieux connaître la disponibilité de la ressource et les effets du changement climatique sur celle-ci ;
– Disposer d’informations précises et régulières, si possible en temps réel, sur les prélèvements opérés en faveur des activités humaines ;
– Protéger l’eau et les milieux aquatiques en se fondant autant que possible sur des solutions naturelles, comme favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol et ralentir le cycle de l’eau ;
– Encourager la sobriété et les économies d’eau pour tous les usages, notamment en accompagnant le monde agricole ;
– Développer le stockage de l’eau sous des formes qui ne nuisent pas aux espaces de stockage naturels que sont les nappes phréatiques ;
– Réutiliser les eaux non conventionnelles et les eaux usées chaque fois que cela est possible ;
– Développer des mécanismes de gouvernance collectifs efficaces et réellement appliqués pour définir le partage de l’eau et penser l’aménagement du territoire en fonction de la ressource ;
– S’interroger sur les moyens budgétaires et sur les outils fiscaux permettant une protection maximale de la ressource tout en responsabilisant les différents acteurs.