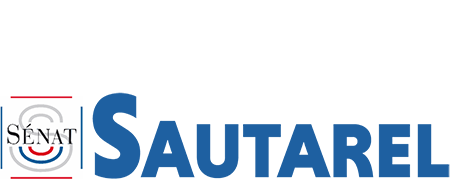Mathieu Darnaud, m’a confié, avec les corapportrices Cécile Cukierman et Céline Boulay-Espéronnier, une mission sur l’avenir et le développement du télétravail.
Le ministère du travail considère quant à lui que 8 millions d’emplois seraient « télétravaillables » dans le secteur privé.
Il semblerait en outre que les salariés français soient ceux qui sont le plus revenus travailler en présentiel après le 1er confinement (devant les allemands, espagnols et italiens).