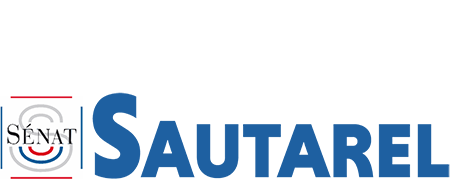L’Europe est entrée dans la « vallée de la mort », pour reprendre les termes de Bertille Bayart, dont je partage ici largement la chronique.
Un long, très long coupe-gorge au cours duquel elle devra survivre à ses dépendances, et donc composer avec des rivaux et des adversaires qui le resteront et des alliés qui n’en sont plus ; faire croire qu’elle est capable d’y remédier beaucoup plus vite qu’elle ne le peut en réalité pour ne pas exposer la réalité crue de ses vulnérabilités ; et construire en même temps son autonomie stratégique, militaire, technologique, financière et énergétique. Il y en a pour une, et plus probablement deux, décennies de traversée.

Les dépendances européennes aux garanties de sécurité et à la technologie américaines, à l’appareil productif chinois et aux hydrocarbures russes et moyen-orientaux étaient acceptables, et même confortables, dans le monde apparemment plat pré-Covid. Elles sont devenues tout juste tolérables dans l’ordre structuré ensuite par la rivalité sino-américaine, dans lequel l’Europe participait au bloc occidental, et par la disqualification de la Russie, devenue un État paria. Elles sont désormais intolérables face à l’hypothèse de la rupture transatlantique, ou pis, face à celle d’un retournement des alliances où Washington préférerait la compagnie des autocrates à la nôtre.

Comment fait-on et avec quel argent ? Il convient de distinguer les sujets. Le premier est celui de l’aide à l’Ukraine, pour la poursuivre, voire l’amplifier, dans la guerre contre la Russie comme dans l’hypothèse d’un accord de cessez-le-feu ou de paix qui nécessitera des garanties puissantes. Sur ce chapitre, plusieurs pistes sont envisagées, au-delà des crédits et des matériels déjà engagés. C’est ici qu’intervient par exemple la controverse sur la confiscation des 200 milliards d’euros d’avoirs russes gelés, qui pourraient servir de réparation anticipée pour l’Ukraine. Au nord de l’Europe, la presse de plusieurs pays scandinaves réclame un effort exceptionnel de la part de la Norvège, dont le fonds souverain a encaissé les bénéfices de la pagaille énergétique déclenchée par le conflit.

Le deuxième sujet est celui des dépenses militaires au sens budgétaire. Celles dont on parle toujours à l’aune des 2 % de PIB dont Donald Trump a dit que les pays européens de l’Otan devraient les porter à 5 %. En France, le contexte justifie en effet de relever l’effort au niveau où il était en pleine guerre froide, soit à au moins 4-5 % du PIB. La loi de programmation militaire est à réviser. Cette accélération de la dépense va être permise par les annonces faites par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mardi : la clause dérogatoire au pacte de stabilité est activée, les dépenses de défense seront sorties du calcul des déficits publics. Sur le paquet de réarmement annoncé de 800 milliards d’euros, cela représente 650 milliards, calculés sur l’hypothèse d’un supplément de dépenses de 1,5 % de PIB. De l’argent virtuel. Aucune suspension de clause n’a jamais fait pousser un euro. À l’échelle européenne, l’effort se traduira probablement par de la dette supplémentaire. Mais la France ne peut pas se le permettre ou, à tout le moins, ne peut partir de l’idée que les vannes sont de nouveau ouvertes. Tous les partis de gouvernement l’admettent : il va falloir faire des choix, revoir la hiérarchie de nos priorités, réorienter massivement nos dépenses et en même temps faire des économies. La seule question est de savoir si on peut se permettre d’attendre la campagne présidentielle de 2027 pour proposer un projet politique qui réintégrera la dimension stratégique et militaire. Sûrement pas !

Le troisième sujet est le financement de l’industrie de défense et de sa chaîne de sous-traitance. Comme pour toute industrie, il se décompose en financement des investissements, du fonds de roulement, et du cycle d’exploitation. Les verrous à l’investissement en fonds propres dans l’industrie de défense restent trop importants. Au problème général de manque de fonds d’investissement en Europe s’ajoute la frilosité à l’égard d’activités mal notées, voire exclues des classifications ESG. Le sujet sera à l’ordre du jour de la conférence de financement organisée par le ministère de l’Économie et celui des Armées le 20 mars. Ce pourrait être l’occasion de lancer un fonds de souveraineté, associant la Caisse des dépôts, Bpifrance, des investisseurs institutionnels français, comme BNP Paribas, Axa ou Oddo, et des « family offices ». La participation des grands industriels de la BITD (base industrielle et technologique de défense) reste en débat. Du côté des crédits bancaires, la situation s’est améliorée : les cas de blocage sont traités par une cellule spécialisée de la Délégation générale pour l’armement (DGA). Mais il reste tous ceux qui n’y font pas appel, ou à qui l’argent coûte plus cher à cause du stigmate « défense », ou qui renoncent à s’engager dans des projets pour l’industrie de défense et préfèrent rester 100 % civil. Or, c’est là une clé de la montée en puissance de l’industrie de défense française et européenne : le développement de la dualité civil-militaire. D’abord parce que cette double casquette permet d’entretenir un outil industriel de grande capacité sans être effectivement en guerre. Ensuite parce que la dualité est un gisement d’innovation extrêmement fécond. L’idée d’un livret A version « mili » semble abandonnée : l’époque n’est pas à créer un nouvel avantage fiscal. Pourtant la mobilisation de l’épargne privée reste une piste.

Est-ce ce que va nous dire le President de la République ce soir?
« Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis », le président de la République Emmanuel Macron a en effet annoncé ce mercredi sur X qu’il s’adressera aux Français dans la soirée.

Est-ce parce qu’il croit peu à la solution européenne que le Président Zelensky a écrit au Président des Etats-Unis pour dire qu’il assure être « prêt à s’asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d’une paix durable » ?
Cette lettre envoyée par Zelensky à Trump pourrait tout changer…
« Zelensky offre un cessez-le-feu partiel avec la Russie pour relancer les négociations de paix », annonce ce matin The Washington Post. Dans un post sur le réseau X, le président ukrainien dit en effet son pays “prêt à travailler rapidement pour mettre fin à la guerre, les premières étapes pouvant être la libération de prisonniers et une trêve immédiate dans les airs […] ainsi qu’en mer, si la Russie fait de même. Après quoi, nous voulons passer très vite par toutes les étapes suivantes et travailler avec les États-Unis pour parvenir à un accord final solide.”
Une source du quotidien avait précédemment indiqué que Washington pourrait revenir sur sa décision de geler l’aide à Kiev “si Volodymyr Zelensky démontrait une volonté authentique de participer à des pourparlers de paix avec la Russie”, écrivait le journal.