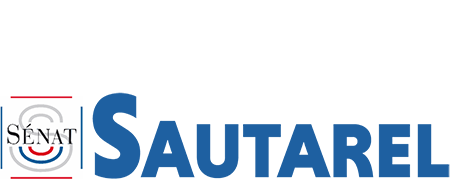J’ai choisi à la veille de cette élection capitale de partager ici le billet de l’excellent Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l’IFRI (Institut français de relations internationales), qui publie une chronique hebdomadaire dans le journal « Les Échos ».
La remise en cause de la démocratie libérale classique doit avoir sa traduction au niveau du système international. L’ordre établi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est lui aussi révolu. Un ordre nouveau qui n’est pas seulement post-américain, mais également post-occidental, serait-il en train d’émerger, de manière certes chaotique, mais irrésistible ? Paradoxalement, c’est au moment où leur pays est le plus divisé et affaibli, que le vote des Américains risque d’avoir le plus de conséquences sur l’équilibre du monde. En choisissant le prochain locataire de la Maison-Blanche, les électeurs américains n’effectuent pas seulement un référendum sur eux-mêmes, (ce qu’ils sont vraiment et veulent devenir). Ils choisissent les paramètres de notre devenir collectif.
Si le scrutin apparaît si incroyablement serré (le plus incertain de l’histoire récente des Etats-Unis), entre un clown dangereux et la candidate de la raison, ce n’est pas seulement parce que la campagne de Kamala Harris s’est révélée au fil des semaines décevante. Mais parce que la société américaine est plus profondément divisée et malade encore, qu’on pouvait le penser. La réélection de Donald Trump – en dépit de la radicalisation que représente la marche sur le Capitole – en serait l’illustration.
Faut-il pour autant utiliser le mot de « fascisme » pour décrire la nouvelle réalité américaine ? Et considérer que Donald Trump est une version modernisée et américanisée de ce que fût en Italie, non pas Silvio Berlusconi, mais Benito Mussolini ? Les mots sont des armes qui peuvent se retourner contre ceux qui les utilisent. Et les analogies historiques sont dangereuses. « L’histoire contient tout et ne nous apprend rien. Sauf qu’il ne faut pas envahir la Russie à la fin de l’été », disait l’historien britannique A. J. P. Taylor.
Et pourtant, la crise de confiance de la société américaine – qui se traduit peut-être par l’impossibilité pour un très grand nombre de voter pour une femme, indépendamment de sa couleur de peau – rappelle celle de la société italienne, (sinon allemande ?) au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour le grand historien américain Robert Paxton, « le fascisme est plus mu par des sentiments que par des idées », et traduit avant tout la peur du déclin et de « l’Autre ». Et ce, dans un univers où la démocratie libérale est accusée de produire des divisions et d’être responsable du déclin.
Sur le plan international, il est intéressant de voir qui espère la victoire de Donald Trump, qui souhaite celle de Kamala Harris, et qui s’abstient de prendre position. De manière schématique, on serait tenté d’affirmer que les puissances révisionnistes comptent sur le triomphe de Trump, les unes parce qu’elle signifie la défaite de la démocratie, sinon la victoire du chaos. C’est le cas bien évidemment de la Russie de Poutine et de la Corée du Nord. Les autres, parce qu’elles attendent une forme d’indulgente neutralité à leurs égards : comme Victor Orban en Hongrie et Benjamin Netanyahou en Israël.
Il est sur ce plan intéressant de noter que près de 80 % des Israéliens voteraient Donald Trump, alors que plus de 70 % des Juifs américains seraient favorables à Kamala Harris. Il y a l’exception chinoise. Officiellement, Pékin ne saurait choisir « entre la peste et le choléra ». Au-delà de cette formulation, il y a une réalité plus sophistiquée. La Chine craint le désordre. Mieux que de nombreux capitalistes américains ou européens, elle perçoit les dangers pour l’économie mondiale et donc pour son taux de croissance, de l’arrivée à la Maison-Blanche d’un homme à ce point imprévisible, sinon profondément déséquilibré.
Vouloir demain, présider au destin du monde, est une chose. Etre confronté au vide, sinon à l’incohérence, en est une autre. Aux Etats-Unis, le « silence » et la « neutralité » des milliardaires « pro-démocratie » sont plus mystérieux encore que l’engagement des conservateurs les plus riches derrière Donald Trump. Mais la perspective de payer moins d’impôts à court terme ne devrait pas aveugler à ce point.
La démocratie et la stabilité sont, dans nos sociétés occidentales au moins, les conditions du bon fonctionnement du capitalisme libéral classique. Le désordre et la violence ne sont pas – c’est le moins que l’on puisse dire – les garanties de l’enrichissement et de la croissance. Bien au contraire. L’idée partagée par certains Européens qu’une victoire de Trump, contraindrait l’Europe à se « réveiller » et permettrait enfin l’émergence d’une « autonomie stratégique » de notre continent, constitue un pari dangereux.
Le populisme avait subi un échec avec la défaite des ultra-conservateurs en Pologne le 15 Octobre 2023. Pour la Hongrie de Victor Orban, un moment isolé, par le retour de Varsovie dans le camp des démocraties libérales classiques, la victoire de Donald Trump, serait tout simplement la confirmation aux yeux du dirigeant hongrois « qu’il avait eu raison avant les autres ». Avec le poison dans le fruit et se répandant dans des pays aussi divers que l’Italie, la France et même l’Allemagne (avec la progression de l’AFD) comment penser que l’Europe pourrait bénéficier de la chute de l’Amérique dans un unilatéralisme aux relents de fascisme ?
En attendant, pendant que le monde a les yeux tournés vers Washington, Poutine avance ses pions en Ukraine avec le soutien des troupes d’élites nord-coréennes, persuadé que Kiev sera contraint d’accepter de négocier aux conditions de Moscou. Poutine sait que les électeurs américains peuvent constituer pour lui une carte plus décisive que l’appoint de troupes fraîches venues d’Asie.
Le 6 Juin 1944, sur les plages de Normandie, l’Amérique contribua de manière décisive, à la victoire sur le fascisme en Europe et dans le monde. Se pourrait-il que quatre-vingt plus tard, elle plonge le camp de la démocratie dans la crise la plus grave, jamais connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Le pire n’est pas sûr, mais il est possible. »
Alexis de Tocqueville dénonçait déjà en 1835 dans son ouvrage « De la démocratie en Amérique » en quoi le pouvoir accordé aux magistrats étasuniens pouvait présenter un risque liberticide. Histoire quand tu nous tiens !